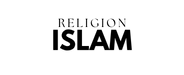– Ghazali a examiné les opinions des philosophes musulmans et a affirmé qu’ils commettaient des erreurs sur dix-sept points et que leurs opinions étaient hérétiques sur trois points. Quels sont ces points ?
Cher frère,
Presque toutes les sources et recherches anciennes et modernes à son sujet convergent sur le fait qu’il était un érudit et un penseur rare dans l’histoire de la science et de la pensée islamiques, un maître des sciences religieuses et rationnelles. Bien que Ghazali ne se soit jamais défini comme tel dans aucun de ses ouvrages, il a été associé à la tradition philosophique et même considéré comme un philosophe, tant par certains érudits classiques que par des chercheurs modernes. En effet, il s’est consacré à la philosophie avec une intensité qui n’a rien à envier aux efforts intellectuels d’un philosophe, et les connaissances qu’il a accumulées grâce à ces efforts ont fait de lui une personnalité que ceux qui lisent et écrivent l’histoire de la philosophie islamique ne peuvent jamais ignorer.
Ce grand penseur a critiqué les philosophes grecs comme Aristote, ainsi que les philosophes musulmans comme Al-Farabi et Avicenne, qui étaient influencés par eux, afin de permettre la formation d’une pensée islamique originale. Cependant, la plupart des gens ont déclaré Ghazali ennemi de la philosophie, en interprétant mal, voire en ne comprenant pas du tout, sa vision de la philosophie. Ils ont présenté la critique par Ghazali des opinions de certains philosophes comme une attaque contre la philosophie elle-même. Cela, ainsi que d’autres raisons, a réduit l’intérêt du monde islamique pour les sciences philosophiques et rationnelles.
Le soufisme a acquis une reconnaissance officielle dans la culture islamique grâce à lui. Avant Ghazali, le soufisme n’était pas bien vu par la majorité des Ahl-i Sunnat. Le fait qu’une personne aussi autorisée dans les sciences islamiques que Ghazali ait accepté et pratiqué personnellement une telle science a servi de preuve de la conformité du soufisme à l’islam.
Un autre service rendu par Ghazali réside dans ses œuvres de réfutation. Le Batinisme, une branche de l’Ismaélisme, constituait à l’époque de Ghazali une grave menace pour le monde islamique, tant sur le plan politique que religieux. D’un côté, ils commettaient des actes de terrorisme, assassinant des savants et des dignitaires, de l’autre, ils interprétaient les croyances et les pratiques religieuses de manière extrémiste, allant jusqu’à l’impiété, en contradiction avec l’exégèse et l’interprétation intérieure de la charia. Ils réussissaient parfois à tromper et à attirer dans leurs rangs les musulmans simples, profitant de leurs faiblesses et employant diverses méthodes. Ghazali, voyant cette situation, a protégé le monde islamique de la menace batiniste par ses avertissements et ses œuvres de réfutation.
Il est vrai qu’après Ghazali, la philosophie n’occupait plus une place aussi importante dans le monde islamique qu’auparavant, mais il faut exclure Ibn Rushd, et on ne peut pas dire que la philosophie ait disparu. Après Ghazali, et particulièrement dans le monde islamique oriental, de nombreuses personnes se sont intéressées à la philosophie, et de nouveaux courants philosophiques sont apparus. Parmi ceux-ci, on peut citer l’illuminisme, le courant représenté par l’école d’Isfahan en Iran au XVIe siècle, ainsi que l’aristotélisme et le courant ibn-sîniste, qui ont été tentés de relancer par Yahyalı Esad Efendi pendant l’ère des tulipes dans l’empire ottoman.
Ghazali a divisé les chercheurs de la vérité de son époque en quatre groupes : les théologiens, les philosophes, les Batinis et les mystiques.
Ce sont ceux qui cherchent à préserver et à défendre l’orthodoxie sunnite contre les attaques des innovateurs. Ils s’efforcent de défendre les fondements de la religion en se basant sur des preuves et des règles logiques.
Ghazali a étudié la philosophie par ses propres efforts. À la suite d’études menées pendant deux ans et basées principalement sur les œuvres de Farabi, Ibn Sina et les Ihwan al-Safa, il a d’abord écrit *Makasidu’l-Falasifa* pour exposer les points de vue des philosophes, puis *Tehafutu’l-Falasifa* pour démontrer l’erreur de certains de leurs arguments. Ghazali a classé les philosophes en trois catégories : les Dehriyyun, les Tabîiyyûn et les İlahiyyun.
Les adeptes du mysticisme intérieur (Batinisme) affirment que tout possède un sens extérieur (zahir) et un sens intérieur (batin), et que le véritable sens est caché dans le batin. Agir selon le zahir conduit à la perdition de l’homme, tandis qu’agir selon le batin conduit à son salut.
En lisant les mystiques et en reconnaissant qu’il ne pouvait pas les comprendre par la seule science, il a cru à la nécessité de l’action en plus de la connaissance. La véritable valeur du soufisme réside dans le fait qu’il est un œil du cœur ouvert sur le monde irrationnel, qu’il combine théorie et pratique, et qu’il tire la vérité de l’expérience vécue.
Dans son ouvrage *al-Munkiz min ad-Dalal*, Ghazali divise les philosophes en trois catégories et les évalue chacun à sa manière à la lumière des critères islamiques. Cependant, son attaque est dirigée directement contre deux importants philosophes néo-platoniciens islamiques, al-Farabi et Ibn Sina, et indirectement contre leur maître, Aristote.
Ghazali divise les philosophes en trois groupes :
Ils défendent l’éternité du monde et, par conséquent, nient le créateur et ne reconnaissent pas l’existence de l’âme. Ils affirment que le monde existe depuis toujours et continuera à exister ainsi à jamais.
Bien qu’ils croient en un Créateur, ils acceptent que l’âme, ainsi que le corps, disparaîtront et ne seront plus jamais ressuscités. En fin de compte, ils nient l’immortalité de l’âme et la vie après la mort.
Bien que totalement différents des deux autres groupes, ils ont également certains points de vue qui ne sont pas conformes à la religion.
Ghazali, considérant que l’impiété des deux premiers groupes était manifestement évidente, n’a pas pris en compte ces derniers et s’est concentré sur les philosophes théologiens. Dans son ouvrage *L’Incohérence des philosophes*, en tant que théologien musulman parfaitement conscient de ce qu’il faisait, il a tenté de réfuter les théologiens à leur propre langage et dans leur propre domaine. Il a examiné et analysé leurs opinions sur seize questions de métaphysique et quatre questions de sciences naturelles. Il affirme que sur ces vingt points, ils sont en hérésie sur 17 et tombent dans l’impiété sur trois.
L’affirmation principale du *Tehafütü’l-Felâsife* est que, en raison de l’insuffisance de la raison pour résoudre les problèmes de théologie, la meilleure attitude pour un musulman est d’accepter les explications religieuses pour résoudre ces problèmes. Sur les vingt opinions abordées dans l’ouvrage, seize concernent la métaphysique et quatre la physique. Il considère dix points comme des innovations et des déviations, mais estime qu’ils ne constituent pas de l’hérésie. Il affirme que sept points sont impossibles à prouver et que trois nécessitent l’excommunication/la contradiction de la religion.
Les philosophes disent que Dieu est un être qui répond aux sollicitations par lui-même, et non un agent libre.
Les philosophes disent que le monde est éternel.
Les philosophes qui affirment que Dieu est le créateur du monde et que l’univers est le fruit de son œuvre sont des hypocrites. Ils disent cela pour dissimuler leurs véritables pensées.
Les philosophes disent que le premier principe, c’est-à-dire Dieu, est un être purement existentiel, sans essence.
Le fait de ne pas reconnaître les attributs d’Allah est une erreur.
Il est faux de dire que le Être Premier ne relève ni de la substance ni de la catégorie.
Il est également faux de dire que Sema agit de son propre gré.
Il est faux de prétendre que les âmes célestes connaissent la totalité de ce monde, avec tous ses détails.
Il est faux de considérer les états extraordinaires, c’est-à-dire les miracles et les prodiges, comme impossibles.
Il est faux que les humains considèrent la mortalité de l’âme et du corps comme impossible.
Les philosophes sont incapables de prouver le créateur et le concepteur de l’univers. L’argument de la possibilité n’est pas suffisant pour prouver l’existence de Dieu.
Les philosophes ne peuvent pas prouver l’unicité de Dieu. Ils ne peuvent pas apporter de preuves solides à ce sujet.
Ils sont incapables de prouver que Dieu n’est pas un être corporel. Ils n’ont aucune preuve à ce sujet.
Les opinions des philosophes aboutissent, en fin de compte, au déni de Dieu.
Ils sont incapables de prouver qu’ils connaissent la nature d’Allah.
Ils sont incapables de prouver que Dieu connaît d’autres choses.
Les affirmations selon lesquelles le ciel se mouvrait par volonté et dans un but précis sont infondées. Il n’existe aucune preuve à ce sujet.
c’est-à-dire les opinions selon lesquelles l’âme ne se réunit pas à nouveau avec le corps après la mort, et que seules les âmes continuent d’exister.
Les philosophes soutiennent que les âmes ressentiront la peine ou le plaisir après la mort. Pour étayer cette affirmation, ils arguent que le monde, c’est-à-dire la matière, est à la fois éternel et fini, tandis que les âmes sont éternelles. Si les corps ressuscitaient, ils seraient insuffisants pour les âmes éternelles.
Ghazali réfute et contredit ces opinions des philosophes. Le fait que le monde soit éternel et les âmes créées ne signifie pas que les âmes soient plus nombreuses que la matière. Même si les âmes étaient plus nombreuses, Dieu ne pourrait-il pas créer suffisamment de matière pour les satisfaire ?
les allégations de ce type.
Selon les philosophes, les événements sont changeants. Dans le changement, la connaissance suit l’objet connu. Lorsque l’objet connu change, la connaissance et celui qui la possède doivent également changer. Par conséquent, si Dieu connaissait les détails/les particularités, Il devrait changer. Or, le changement de Dieu est impossible. Donc, Dieu ne connaît pas les détails/les particularités.
La connaissance est une relation/un rapport à la personne qui connaît. Lorsque la relation change, la personne elle-même reste inchangée. Par exemple, si une personne qui se trouve à ma gauche passe à ma droite, ce n’est pas moi qui change, mais elle. D’autre part, si le changement de la connaissance modifie quelque chose dans la personne qui connaît, alors à mesure que la connaissance se diversifie, la personne elle-même devrait se diversifier/changer. Connaître l’homme, l’animal et le végétal implique-t-il la présence de plusieurs personnes distinctes en un seul individu ? De plus, les philosophes considèrent à la fois Dieu et le monde comme éternels/anciens. Puis ils affirment qu’il y a du changement dans le monde. Or, ils ne peuvent pas et ne peuvent pas faire la même affirmation concernant Dieu. Cela ne montre-t-il pas qu’ils sont en contradiction ?
des pensées de ce genre.
Cliquez ici pour plus d’informations :
Avec mes salutations et mes prières…
L’Islam à travers les questions