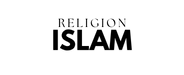– On entend dire que le sacrifice existe depuis toujours dans l’histoire de l’humanité. Pourriez-vous nous donner brièvement des informations sur le culte du sacrifice dans les religions divines et non divines et comparer ces pratiques ?
Cher frère,
La victime,
Ce sont des êtres et des objets offerts dans le but de se rapprocher d’une ou plusieurs entités surnaturelles vénérées, d’exprimer sa gratitude, de demander quelque chose ou d’expiation pour les péchés.
En général, les objets offerts à une puissance surnaturelle.
à la présentation
lorsque son nom est mentionné,
victime
Le terme est particulièrement utilisé pour désigner les offrandes faites par le biais de l’abattage ou de la boucherie. L’élément essentiel du sacrifice est la présence d’une force surnaturelle ou d’une entité à laquelle une telle force est attribuée, capable d’accepter le don offert. La personne qui offre le sacrifice vise ainsi à entrer en relation avec la force surnaturelle ou à maintenir une relation déjà établie.
D’autre part, dans certaines sociétés, la destruction des objets offerts en sacrifice est considérée comme un principe fondamental, et le sacrifice est donc…
« un rite cultuel au cours duquel des objets sont offerts à une divinité ou à une force surnaturelle quelconque »
est défini comme suit. Le sacrifice est considéré comme l’acte par lequel le donateur retire quelque chose de sa propre possession et le présente à un destinataire surnaturel.
« Cérémonie religieuse au cours de laquelle quelque chose est offert ou détruit, et qui établit des relations entre un objet et une source de pouvoir spirituel, d’une part, et une personne qui a besoin d’un tel pouvoir, d’autre part. »
a été décrit comme suit.
Dès le Paléolithique ancien, diverses cultures ont développé des pratiques distinctes de culte sacrificiel. Dans la religion grecque antique, des animaux noirs étaient offerts aux dieux des enfers et de la mer, des animaux rouges aux dieux du feu, des chevaux rapides au dieu soleil Hélios, et des taureaux, considérés comme des symboles des forces cosmiques de fertilité, au dieu Zeus.
On croyait que les dieux vivaient grâce aux sacrifices, et que l’humanité et la nature vivaient grâce aux dieux.
Les découvertes archéologiques,
Cela montre qu’il existait dans l’Égypte ancienne un culte sacrificiel pratiqué rituellement sous la direction des prêtres.
Les Sumériens
Dans l’ancienne Mésopotamie, où vivait le peuple d’Abraham, il existait également des calendriers de fêtes très élaborés, qui comprenaient des sacrifices obligatoires accompagnés de prêtres.
Les Hittites
On sait que les gens offraient des sacrifices et des aliments aux dieux pour gagner leur faveur et leur pardon. (Réf. religieuse et mythologique)
Ougarit
On trouve dans ces textes des traces d’un culte sacrificiel présentant des caractéristiques mésopotamiennes et cananéennes.
Selon des inscriptions datant du premier millénaire avant J.-C., les hautes cultures de l’Arabie du Sud pratiquaient des rituels sacrificiels dirigés par des prêtres, où des offrandes étaient faites aux grands dieux, ainsi qu’aux étoiles comme le soleil, la lune et Vénus.
Les Iraniens
Ils offraient des sacrifices aux dieux, diverses plantes et la boisson haoma.
Zoroastre
en interdisant le sacrifice d’animaux
Ahura Mazda
Bien qu’il ait prôné le sacrifice de vœux et de remerciements, la coutume du sacrifice d’animaux vivants a été rétablie après sa mort.
Les Iraniens ont fait des offrandes et rendu grâce.
Hormuz
‘e, et qu’il empêche aussi les autres présentations de faire du mal.
Ehrimen
ils lui faisaient leurs soumissions.
Sabiens
Dans cette société, les cérémonies au cours desquelles des pigeons et des béliers étaient sacrifiés étaient menées par un prêtre baptisé ou son assistant, et il était interdit aux non-baptisés de toucher l’animal sacrifié, car on croyait à sa sacralité.
Dans les tribus primitives actuelles, le sacrifice de poulets est courant pour obtenir l’aide des dieux, se protéger de leur colère ou se purifier de ses péchés. Des bovins et des chiens sont également sacrifiés, et des offrandes de nourriture et de boissons sont faites.
La religion japonaise, le Shintoïsme.
Les sacrifices et les offrandes étaient présentés aux dieux et aux morts pour apaiser leur colère, obtenir leur faveur et leur aide, ou pour expier les péchés. Les sacrifices humains, pratiqués à l’origine, ont été remplacés par des sacrifices d’animaux. Aujourd’hui, on offre en sacrifice des offrandes alimentaires à base de riz et de vin de riz, ainsi que tout ce qui correspond aux trois besoins essentiels, à savoir les vêtements, le logement et la nourriture.
Dans la Chine ancienne
Des animaux domestiques et sauvages étaient sacrifiés aux dieux et aux esprits des ancêtres décédés afin de les apaiser et d’obtenir des faveurs divines ; des offrandes de céréales, de boissons fermentées, de divers aliments et de soie étaient également présentées. Le sacrifice humain, autrefois courant, a été aboli avec Confucius. Le sacrifice offert par l’empereur au ciel et à la terre lors du solstice d’hiver occupait une place importante. Les offrandes les plus importantes étaient faites lors des premiers et derniers jours de l’année, lorsque toute la famille se réunissait. Des sacrifices appropriés étaient également offerts en cas d’éclipse solaire, d’inondations, de maladies, de sécheresse ou de famine.
Dans l’hindouisme
Le sacrifice est l’un des chemins qui mènent les gens au salut.
Les Brahmanes
À cette époque, les sacrifices étaient effectués sous la supervision des prêtres, car on pensait qu’ils engendraient une force cosmique et que le mystère de la création était la clé de la pérennité de l’univers.
Adieux
À cette époque, les cérémonies quotidiennes comprenaient des offrandes brûlées sur le feu, le versement de la boisson sacrée soma sur le sol, et des offrandes de nourriture aux ancêtres, aux dieux de la terre et aux esprits. Les offrandes mensuelles étaient des gâteaux et des aliments offerts aux différents dieux, en particulier au dieu de la tempête Indra, lors de la nouvelle lune et de la pleine lune. Cependant, des sacrifices saisonniers étaient offerts trois fois par an par les prêtres, avec l’intention d’expiation et dans l’espoir de la prospérité au début du printemps, ainsi que pour la saison des pluies et l’espoir d’un hiver frais. Le système des sacrifices a été conservé après la période des Upanishads, mais l’apparition du culte des temples et…
Bouddhisme, jaïnisme
Il a progressivement perdu de son importance en raison de l’opposition de nouvelles religions telles que le bouddhisme et le jaïnisme.
« Ahimsa »
En raison du principe de non-violence (ne pas tuer aucun être vivant) et de la croyance en la réincarnation, aucun sacrifice d’êtres vivants n’est pratiqué. Cependant, les adeptes des deux religions offraient de l’encens, des bougies, des parfums, de la nourriture et des boissons dans leurs lieux de culte.
Dans le judaïsme
L’histoire du culte du sacrifice, qui consiste à détruire totalement ou partiellement certains animaux ou aliments sur un autel comme signe de dévotion à Dieu et dans le but d’obtenir Sa grâce et Son pardon, remonte à Abraham. À son époque…
bétail, troupeau, colombe, pigeon
Des animaux, comme ceux-ci, étaient offerts à Tann. La tradition des sacrifices, poursuivie par Isaac et son fils Jacob, a perduré chez les Israélites, avec des pratiques différentes à certaines périodes, jusqu’à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70.
Ancien Testament
Le terme le plus complet pour désigner la victime en hébreu est
« donner »
signifiant
« manah »
dérivé du verbe
« un don ou une taxe »
au sens de
« de »
Ce mot a été utilisé pour désigner les offrandes de céréales en général, ainsi que les sacrifices, et plus particulièrement les sacrifices d’animaux.
Dans le judaïsme, le sacrifice,
Les sacrifices sont divisés en deux catégories : les sacrifices sanglants, offerts en égorgeant des animaux appropriés, et les sacrifices non sanglants, consistant à présenter divers aliments, boissons comme l’eau et le vin. Les sacrifices étaient offerts quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, saisonnièrement et annuellement.
Les pratiques de sacrifice à l’époque de Jésus-Christ.
Ancien Testament
Bien que cela soit basé sur le sacrifice de l’agneau pascal, le christianisme a ensuite développé une conception différente du sacrifice qui mettait l’accent sur Jésus. Lorsque Jésus, lui-même Israélite, est né, sa famille, suivant la loi juive, a offert un sacrifice.
Jérusalem
Il est allé à ‘ et a emmené Jésus avec lui. Jésus a participé aux fêtes de Pâque que les enfants d’Israël célébraient.
D’autre part, Jésus
Après avoir guéri un lépreux, il lui a demandé de présenter un sacrifice, comme le prescrit la loi de Moïse, et il a demandé à celui qui était en désaccord avec son frère de présenter un sacrifice après la réconciliation. Malgré ces pratiques, on sait que la croyance en la crucifixion et la résurrection de Jésus a commencé à faire de la chrétienté une religion distincte du judaïsme. En effet, dans la tradition chrétienne, Jésus a mentionné le sang versé pour les hommes lors du dernier repas qu’il a partagé avec ses apôtres.
Nouveau Testament
Ce repas, considéré comme la célébration de la Pâque de l’Ancien Testament, qui était censée être un sacrifice pour le pardon des péchés et la réconciliation des hommes avec Dieu, a été interprété comme un rite dans lequel Jésus s’offrait à son Père.
Dans les Évangiles,
« Le sang de Jésus a été répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. »
« Le Fils de l’homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour beaucoup. »
et dans les lettres de Paul
« une victime pour le péché »
et
« Sacrifice à Dieu »
Ces expressions ont constitué la base de la croyance qui considère Jésus-Christ comme un sacrifice qui sauve l’humanité du péché originel. Ainsi, dans la théologie chrétienne, la croyance que la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice unique et suffisant, rendant inutiles les autres actes de sacrifice, a été acceptée, Jésus étant le premier et le dernier sacrifice, abolissant ainsi le système de sacrifice de l’Ancien Testament.
I
Le sacrifice dans l’islam :
Le rite du sacrifice, qui existait dans les religions et cultures antérieures, bien que sous des formes et avec des objectifs différents, et qui occupait une place importante dans la vie religieuse de la société de l’ère préislamique, a été purifié dans la religion islamique des éléments négatifs tels que le meurtre, le polythéisme, le gaspillage, la maltraitance des animaux et la pollution de l’environnement, prenant ainsi la forme d’un culte qui combine des aspects religieux, financiers et sociaux.
Dans la société arabe préislamique
Bien que l’on trouve des traces, même faibles, de la coutume de sacrifier des enfants, des esclaves et des captifs aux idoles, la pratique la plus répandue était le sacrifice d’animaux. Les Arabes de l’ère préislamique, à certaines occasions ou lors d’événements importants, offraient des chameaux, des bovins, des moutons, des gazelles, etc., devant les idoles, tant à la Kaaba qu’ailleurs à La Mecque et dans d’autres régions, afin de montrer leur respect pour le sanctuaire, leur dévotion aux idoles et de se rapprocher d’elles. Ils tuaient les animaux, versaient leur sang sur les idoles, déchiraient la bête et la laissaient sur ces pierres dressées, attendant que les animaux et les oiseaux de proie la mangent. On pensait que le sacrifice apportait des bienfaits, aussi bien au pied de la tombe d’un défunt que pour se protéger des djinn. De plus, on sacrifiait un animal pour la naissance d’un enfant, un sacrifice d’aqîqah, et on organisait un banquet. On sacrifiait aussi le premier-né d’un chameau ou d’un mouton dans l’espoir d’apporter la prospérité.
(fera’, fer’a),
Durant les dix premiers jours du mois de Rajab
« atîre »
On sait que le mouton appelé « Bura » était sacrifié aux idoles. À l’époque de l’Islam, la coutume du sacrifice des Arabes de la Jâhiliyya a été purifiée des éléments contraires à la croyance en l’unicité de Dieu, puis réhabilitée conformément à la tradition d’Abraham et enrichie de fonctions sociales.
L’entreprise de sacrifice d’animaux pour les idoles,
Les animaux abattus de cette manière étaient considérés comme impurs, et la coutume du sacrifice d’aqiqah a été conservée dans ses grandes lignes à l’époque de l’islam. Les deux derniers types de sacrifices, quant à eux, étaient considérés comme permis au début de l’islam, à condition qu’ils soient offerts à Dieu, mais plus tard…
« Il n’y a ni ferâ’ ni atîre dans l’Islam. »
(Bukhari, « L’Aqiqa », 3, 4 ; Muslim, « Les sacrifices », 38)
est interdit par un hadith.
Le Coran mentionne, sans entrer dans les détails, que les deux fils d’Adam offrirent un sacrifice à Dieu, et il est indiqué que le sacrifice est une pratique religieuse dans toutes les religions divines. Bien que le Coran contienne certains préceptes concernant les sacrifices à accomplir pendant le pèlerinage du Hajj, il ne traite pas du sacrifice en dehors du Hajj, sauf par une allusion indirecte. Conformément à la politique législative suivie en matière de culte, les préceptes concernant l’obligation de sacrifice, tant pour les pèlerins du Hajj et de l’Omra que pour les autres personnes, ainsi que les autres types de sacrifices, ont été déterminés par les paroles et les pratiques du Prophète.
À partir de la 2e année de l’Hégire du Prophète (624)
Le début de la pratique du sacrifice de l’agneau pendant les fêtes de l’Aïd al-Adha, son application pendant le Hajj et l’Omra, ainsi que les riches traditions hâtidiques comprenant diverses explications sur le sacrifice, constituent le fondement principal de la tradition religieuse, des interprétations et des évaluations juridiques dans ce domaine.
Dans les actes de culte, des éléments explicables par l’utilité individuelle et collective coexistent souvent avec des comportements symboliques de nature cultuelle, représentant la dévotion à Dieu. Cependant, dans le sacrifice, acte de culte financier, bien que des aspects cultuels soient présents, l’utilité individuelle et collective prédomine. La différence fondamentale entre le sacrifice et l’abattage d’un animal pour sa viande ou sa peau (zabt, tezkiye) réside dans le fait que le sacrifice est pratiqué dans le but d’obtenir la faveur de Dieu et de se soumettre à sa volonté. Ce but, qui constitue l’essence du culte, n’est réalisé que si les conditions formelles prescrites par le législateur sont respectées. À cet égard, l’essence et la forme du sacrifice reposent sur la révélation religieuse. La consommation de la viande du bétail sacrifié et l’utilisation maximale de sa peau et de ses autres parties ne sont pas des exigences liées à l’essence du culte, mais des avantages secondaires, considérés comme l’aspect et le sens mondains du culte. Dans la doctrine classique, le fait que le rituel du sacrifice soit défini comme le saignement n’est pas une opération abstraite, mais signifie que l’on choisit comme critère un processus objectif qui représente la conscience et la volonté de servitude, un état intérieur dans ce culte, et qui se situe au seuil inférieur de l’obligation.
En sacrifiant un animal, une personne manifeste de manière tangible son obéissance aux commandements d’Allah et préserve son sens de la servitude.
Il est demandé de le faire non pas en gaspillant ses biens pour Dieu, mais de manière à être utile aux gens, en commençant par ses proches. Le fait que le Coran indique que ce n’est pas le sang et la chair du sacrifice qui atteignent Dieu, mais la sensibilité religieuse (takwa) de ceux qui sacrifient, en témoigne. Le sacrifice signifie également la gratitude pour les bienfaits que Dieu a accordés. À chaque sacrifice, les croyants renouvellent le souvenir de l’épreuve réussie qu’Abraham et son fils Ismaël ont passée, comme le résume le Coran, en matière d’obéissance absolue aux commandements de Dieu, et montrent symboliquement qu’ils sont prêts à une obéissance similaire.
L’offrande sacrificielle maintient vivants l’esprit de fraternité, d’entraide et de solidarité dans la société ; elle contribue à la réalisation de la justice sociale.
Ce rôle est particulièrement évident dans les environnements où les pauvres n’ont pas ou ont très peu la possibilité d’acheter de la viande. Il donne au riche le plaisir et l’habitude de dépenser son bien dans le sens de la satisfaction divine, de l’entraide et du partage, le préservant ainsi de la cupidité et de l’attachement aux biens terrestres. Il permet au pauvre, par l’intermédiaire des riches, de rendre grâce à Dieu, de se libérer du pessimisme et de l’hostilité face à la distribution des biens terrestres, et de se sentir membre de sa communauté.
L’utilité du sacrifice animal ne peut pas être réduite à la simple solidarité sociale et à l’aide financière.
Comme chaque acte de culte a sa propre signification et sa propre sagesse, tant dans sa forme que dans son essence, il est possible de remplacer le sacrifice par un autre acte de culte, par exemple en distribuant l’argent du sacrifice, en fournissant de la nourriture aux pauvres, en accomplissant des prières et en observant le jeûne.
ce n’est pas permis.
(Pour plus d’informations et les sources, voir l’Encyclopédie de l’Islam de la Fondation Diyanet, entrée « Kurban ».)
Avec mes salutations et mes prières…
L’Islam à travers les questions