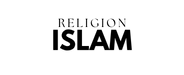Cher frère,
(mort en 981/1573)
Il est également connu comme un grand érudit turc qui a produit des œuvres dans divers domaines.
Ses critiques concernent des pensées et des opinions qu’il considère comme contraires à la tradition sunnite et non conformes au soufisme sunnite.
Par exemple, Birgivi le mentionne à plusieurs reprises dans son ouvrage, qui utilise des sources telles que l’Ihya et la Risale de Kusayri.
En effet, contrairement à la conception très répandue à son époque, il n’a dédié aucun de ses ouvrages à un dignitaire de l’État. Au contraire, il a courageusement critiqué les défauts qu’il observait chez les dirigeants et les fonctionnaires de tous niveaux, y compris les hauts fonctionnaires de l’État. En particulier, la vente des postes de fonctionnaires contre des pots-de-vin, la corruption des juges, des contrôleurs des marchés et d’autres fonctionnaires, l’attribution de grades scientifiques et administratifs à des personnes non compétentes, la propagation de l’ignorance en conséquence, ainsi que toutes sortes d’innovations et de superstitions, sont des questions auxquelles Birgivî s’est fermement opposé.
Bien qu’il fût lui-même un membre de la confrérie Bayrami, il n’a pas hésité à critiquer certains maîtres soufis qui, à son époque, s’étaient écartés des principes sunnites et avaient introduit des innovations, et il a même été accusé d’être un ennemi du soufisme parce qu’il avait écrit un traité intitulé « Exposer et critiquer les innovations et les excès de certains soufis », mais cette accusation a été jugée infondée.
En effet, le célèbre mystique Abdülganî en-Nablusî (mort en 1143 / 1731), l’un des commentateurs de « et-Tarîkatü’l-Muhammediyye », le mentionne.
En fait, le fait qu’il ait tiré un très large parti de l’ouvrage de Ghazali lors de la rédaction de son propre ouvrage en est une preuve évidente.
D’autre part, il apparaît également dans un traité écrit par son élève Hocazade Abdunnasır d’Akşehir, traduit en turc par Kuşadalı Ahmed Efendi, qui décrit un aperçu de la vie de Birgivî sur vingt-quatre heures.
Cependant, contrairement à de nombreux érudits ottomans, Birgivî a suivi les évolutions sociales avec une approche critique. En effet, le fait que Birgivî ait déjà anticipé les développements sociaux et moraux négatifs, ressentis dans divers segments de la société, notamment parmi les élites telles que les hommes d’État, les érudits et les mystiques, et qui furent plus tard présentés par de nombreux savants et hommes d’État ottomans comme les causes intrinsèques du déclin de l’Empire, et les conséquences dangereuses qui en découlaient, montre qu’il était l’un des rares intellectuels de son époque parmi les érudits ottomans à suivre les évolutions sociales.
Le fait que ses œuvres aient été très appréciées à toutes les époques, en particulier, doit être considéré comme le résultat d’une personnalité non seulement dotée d’une grande connaissance scientifique, mais aussi honnête, prudente, courageuse et responsable face aux problèmes sociaux.
C’est un ouvrage en arabe de Birgivî Mehmed Efendi traitant de questions morales dans le contexte du Coran et de la Sunna.
Son titre complet est . Le contenu de l’œuvre est divisé par l’auteur en trois parties principales (chapitres), chaque partie étant elle-même divisée en trois sous-parties (sections).
Il traite de la fidélité au Coran et à la Sunna, de l’éloignement des innovations religieuses (bid’ah) et de l’évitement de l’excès dans l’accomplissement des actes de culte. En s’appuyant sur le Coran et les hadiths, l’importance de la fidélité au Coran et à la Sunna est soulignée, et après avoir présenté certains récits sur les dangers des innovations religieuses, il est expliqué, avec une approche modérée, quels comportements entrent dans le cadre des innovations religieuses à éviter.
Il a été démontré, à l’aide de versets coraniques et de hadiths, ainsi que des opinions des jurisconsultes, que l’excès dans l’accomplissement des actes de culte et dans d’autres domaines est incompatible avec l’islam, religion de la modération.
Le volume de l’ouvrage consacré aux questions importantes de l’islamisme représente 250 pages sur un total de 300 pages dans l’édition de Chaybani.
Le premier chapitre énumère brièvement les points qui entraînent l’apostasie et ceux qui ne l’entraînent pas, et soutient que, dans ce contexte, les opinions extrêmes et certaines opinions de certains de ses membres entraînent l’apostasie.
À la fin de ce chapitre, Birgivî mentionne que l’un des membres de la confrérie soufie de son époque, citant son maître, a affirmé qu’un de ses proches voyait Dieu une ou deux fois par jour. Il note également que certains membres de sa confrérie ont déclaré que, spirituellement, ils étaient supérieurs aux prophètes autres que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui), ainsi qu’aux compagnons, à commencer par Abu Bakr.
Après avoir mentionné que ces interprétations, contraires au consensus des savants, conduisent à l’incrédulité, l’auteur énumère certains hadiths sur les vertus des compagnons du Prophète.
Il est question ici des sciences dont l’objectif est d’être mises en pratique, et non pas d’être simplement apprises, telles que la théologie, l’astrologie, la dialectique et la controverse, qui ne sont pas considérées comme des disciplines à acquérir au-delà du nécessaire. Le texte aborde également les vertus des actes de culte, les sunna et les makruh, ainsi que les sciences recommandées, incluant l’apprentissage de la médecine. Il cite des versets coraniques et des hadiths sur les vertus de la recherche de la connaissance, tout en critiquant l’affirmation, soutenue par certains à l’époque de l’auteur, selon laquelle la connaissance serait un voile, et que tout pourrait être connu par la découverte.
Il traite de la piété et occupe plus des deux tiers de l’ouvrage, ce qui laisse penser qu’il constitue l’objectif principal de la rédaction du livre.
Dans cette partie, l’importance de la piété (taqwa) est soulignée à partir de versets coraniques et de hadiths, puis, sur plus de 200 pages, les domaines d’application de la piété sont abordés. Environ soixante questions, entre autres, sont expliquées ici, non seulement à partir de versets coraniques, mais aussi de nombreux hadiths et traditions.
À l’instar du plan suivi par Ghazali dans son ouvrage Ihya, les vices de la langue, des yeux et des autres organes sont abordés, et les mauvais caractères sont décrits tout en expliquant les comportements positifs qui leur correspondent.
Il s’agit de questions qui, bien qu’elles ne relèvent pas de la piété, sont considérées à tort comme telles.
Birgivî affirme que ces aspects, que certains ascètes de son époque considéraient comme importants, n’étaient rien d’autre que des innovations et un mysticisme grossier apparus après les premiers temps de l’islam.
Le chapitre explique, à l’aide de citations tirées des livres de jurisprudence hanafite, pourquoi il est inutile d’être excessivement méticuleux lors du nettoyage pour les prières et autres actes d’adoration.
L’ouvrage souligne la légitimité de l’amitié et de la compagnie des personnes travaillant dans les fondations et les administrations publiques, ainsi que la licéité de consommer leurs repas, en citant des sources hanafites. Il est également mentionné qu’il est permis de manger dans des récipients appartenant à des polythéistes et de consommer des repas préparés par des juifs et des chrétiens.
Il évoque certains points que certains individus mettent en avant en pensant qu’ils sont un moyen de se rapprocher d’Allah, et qu’il qualifie de bid’ah (innovation religieuse).
Parmi les hadiths abondamment cités dans le livre, on trouve des récits dont l’authenticité est contestée.
Il semble que Birgivî ait adopté une position assez stricte concernant l’excommunication des individus qui commettent des actes qui les font sortir du cercle de la foi, ainsi que de certaines sectes islamiques.
Avec mes salutations et mes prières…
L’Islam à travers les questions